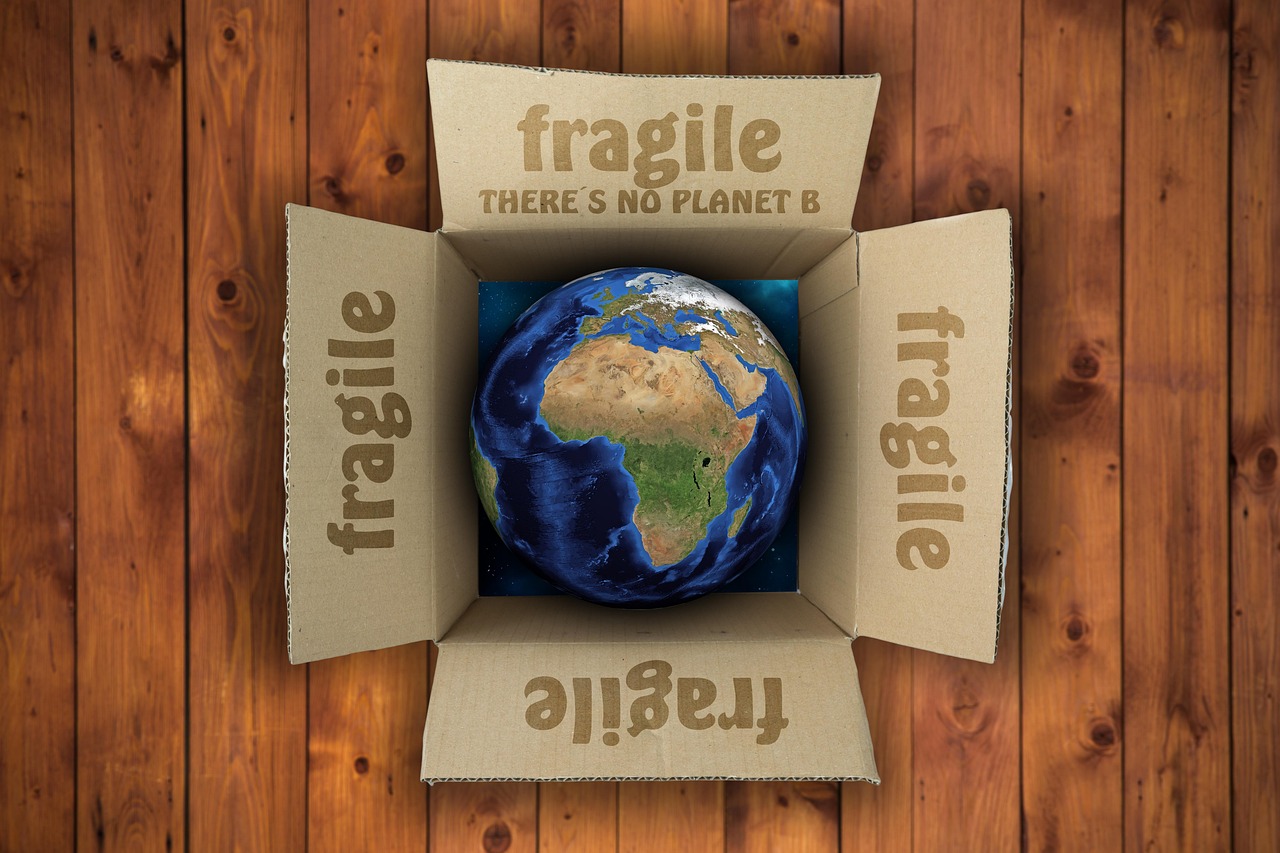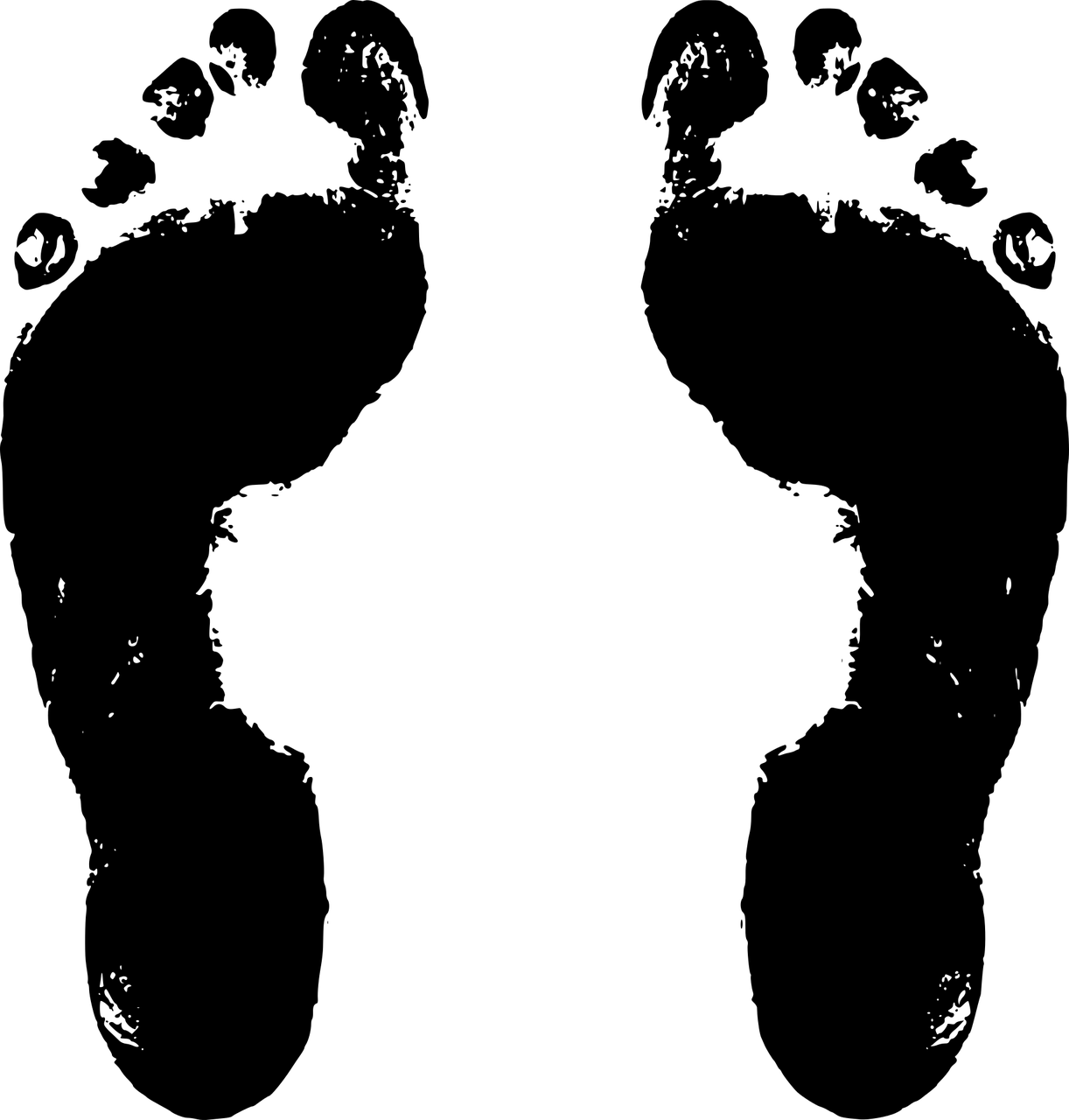|
EN BREF
|
Les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) issues de l’agriculture représentent 14%, dont 60% proviennent de l’élevage. Les principaux gaz en cause sont le méthane, le protoxyde d’azote et le dioxyde de carbone, qui proviennent de différentes sources telles que la digestion des ruminants, l’utilisation d’engrais et le transport. Afin de réduire ces émissions, l’Union européenne et la France visent une neutralité carbone d’ici 2050, avec un accent particulier sur la réduction des émissions de méthane, qui représente 45% des émissions agricoles en France. Les recherches actuelles se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité alimentaire, la sélection génétique, l’épigénétique, ainsi que sur des pratiques agricoles durables, tout en valorisant le rôle de l’élevage dans les cycles biogéochimiques et le stockage de carbone.
Dans un contexte de changement climatique, l’empreinte carbone de l’élevage s’impose comme un enjeu majeur qui combine à la fois préoccupations environnementales et exigences de sécurité alimentaire. Cet article se penche sur les principales émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à l’élevage, examine les impacts environnementaux associ és, tout en proposant des perspectives innovantes pour une agriculture plus durable. Par différents angles d’analyse, nous mettrons en lumière les défis à relever, les initiatives en cours et les pistes de recherche qui pourraient contribuer à une diminution significative de l’impact carbone de ce secteur crucial.
Une empreinte carbone significative
Les études montrent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues à l’agriculture sont responsables de 14 % des émissions totales, dont environ 60 % proviennent de l’élevage seul. Parmi les GES les plus problématiques pour l’élevage, on retrouve le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et le dioxyde de carbone (CO2). Le méthane, notamment émis lors de la digestion des ruminants, possède un pouvoir de réchauffement global 28 fois supérieur à celui du CO2. Les émissions indirectes liées à la production et au transport des aliments animaux soulignent également l’ampleur de l’empreinte carbone.
Les sources d’émissions dans l’élevage
Il est important de distinguer les différentes sources d’émissions. Le méthane provient principalement des fermentations intestinales des ruminants et des effluents de diverses espèces animales. À ce jour, l’élevage bovin représente à lui seul 16 % des émissions mondiales de méthane. Le protoxyde d’azote est généré par l’utilisation d’engrais, tandis que le CO2, qui résulte des activités de transport et d’énergie au sein des exploitations, constitue une part inévitable également liée aux machines utilisées.
Évolution des émissions de méthane en Europe et dans le monde
Sur le continent européen, des efforts notables ont été réalisés pour réduire les émissions de méthane dues à l’agriculture, avec une baisse de 39 % entre 1990 et 2020. Cependant, à l’échelle mondiale, la concentration de méthane dans l’atmosphère continue d’augmenter, suivant un scénario climatique pessimiste selon les prévisions des experts du GIEC. Cela souligne la nécessité d’une action urgente et concertée à l’échelle internationale afin de maîtriser cette problématique.
Les stratégies française et européenne
La Stratégie nationale bas-carbone en France prévoit des émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050. Les systèmes d’élevage extensifs, qui valorisent des produits végétaux non consommables par l’homme, jouent un rôle crucial dans cette démarche. L’intérêt croissant pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes amène à redéfinir les pratiques de l’élevage afin de développer des solutions agri-environnementales.
Objectif réduction des émissions de méthane
Pour Tomber à 45 % des émissions de GES de l’agriculture en France, des recherches sont en cours pour optimiser les pratiques d’élevage. Le programme METHANE 2030 vise une réduction de 30 % des émissions des filières bovines sur une période de dix ans, en intégrant des solutions scientifiques, comme l’amélioration génétique et des ajustements alimentaires.
Rôle crucial de l’alimentation
L’alimentation des animaux représente un levier majeur pour la réduction de l’empreinte carbone. Les efforts se concentrent sur l’utilisation de ressources non-potentielles pour l’alimentation humaine, ainsi que sur le développement d’aliments à faible bilan carbone, particulièrement pour les monogastriques. L’outil Ecoalim, innové par l’INRAE, permet d’évaluer le bilan carbone des aliments afin d’obtenir les meilleures pratiques nutritionnelles.
L’efficience alimentaire : un autre levier d’optimisation
Améliorer l’efficience alimentaire des animaux est essentiel pour diminuer l’impact environnemental. L’utilisation d’enzymes comme la phytase microbienne pour favoriser l’assimilation des phosphates tout en prévenant les pertes de nutriments est une des nombreuses initiatives en cours. De plus, la création de partenariats internationaux dans le domaine de la recherche renforce les capacités d’innovation à l’échelle globale.
Les innovations génétiques pour des élevages plus durables
Les recherches en génétique et épigénétique représentent un autre axe prometteur pour réduire les émissions de méthane. Ces avancées permettent de sélectionner les meilleures souches d’animaux, adaptées à un environnement économique et écologique fluctuant, tout en limitant l’empreinte carbone de l’élevage.
L’élevage au cœur des cycles biogéochimiques
Émetteur de GES, l’élevage joue également un rôle central dans le maintien des cycles biogéochimiques des éléments nutritifs. La valorisation des effluents dans les pratiques culturales permet d’améliorer la fertilité des sols et de recycler les nutriments, ce qui peut contribuer à la réduction des apports d’engrais de synthèse, réduisant ainsi l’empreinte carbone globale.
La valorisation des services environnementaux
Les prairies et l’élevage offrent des services environnementaux essentiels, souvent peu valorisés. Preserving biodiversité, stockage de carbone et contribution à la santé des écosystèmes sont autant d’avantages qui rendent la reconnaissance de l’élevage durable fondamental. Le développement de paiements pour services environnementaux pourrait inciter les agriculteurs à adopter des pratiques plus durables.
Les prairies : essences rénovatrices
Les prairies permanentes contribuent non seulement à la biodiversité, mais elles jouent également un rôle crucial dans le stockage de carbone. Lorsqu’elles sont bien gérées, elles permettent d’absorber des quantités significatives de CO2, tout en offrant un habitat pour la faune. Le pâturage contrôlé est, de ce fait, un élément essentiel pour la durabilité des écosystèmes régionaux.
Perspectives vers un avenir durable
Pour améliorer le bilan environnemental de l’élevage, les politiques publiques doivent encourager une transition vers des systèmes plus durables. Cela inclut des incitations à la recherche pour optimiser les pratiques existantes, tout en intégrant les exigences alimentaires et les réalités économiques des éleveurs. L’évolution vers une agriculture durable nécessitera un engagement fort et collectif des acteurs du secteur.
Les défis auxquels fait face l’élevage sont considérables, mais les perspectives d’innovation sont prometteuses. En redéfinissant nos pratiques autour de la durabilité, de l’efficience et de la réduction des émissions de GES, il est possible d’envisager un avenir où l’élevage et la protection de l’environnement ne sont pas en opposition, mais bien en complémentarité.
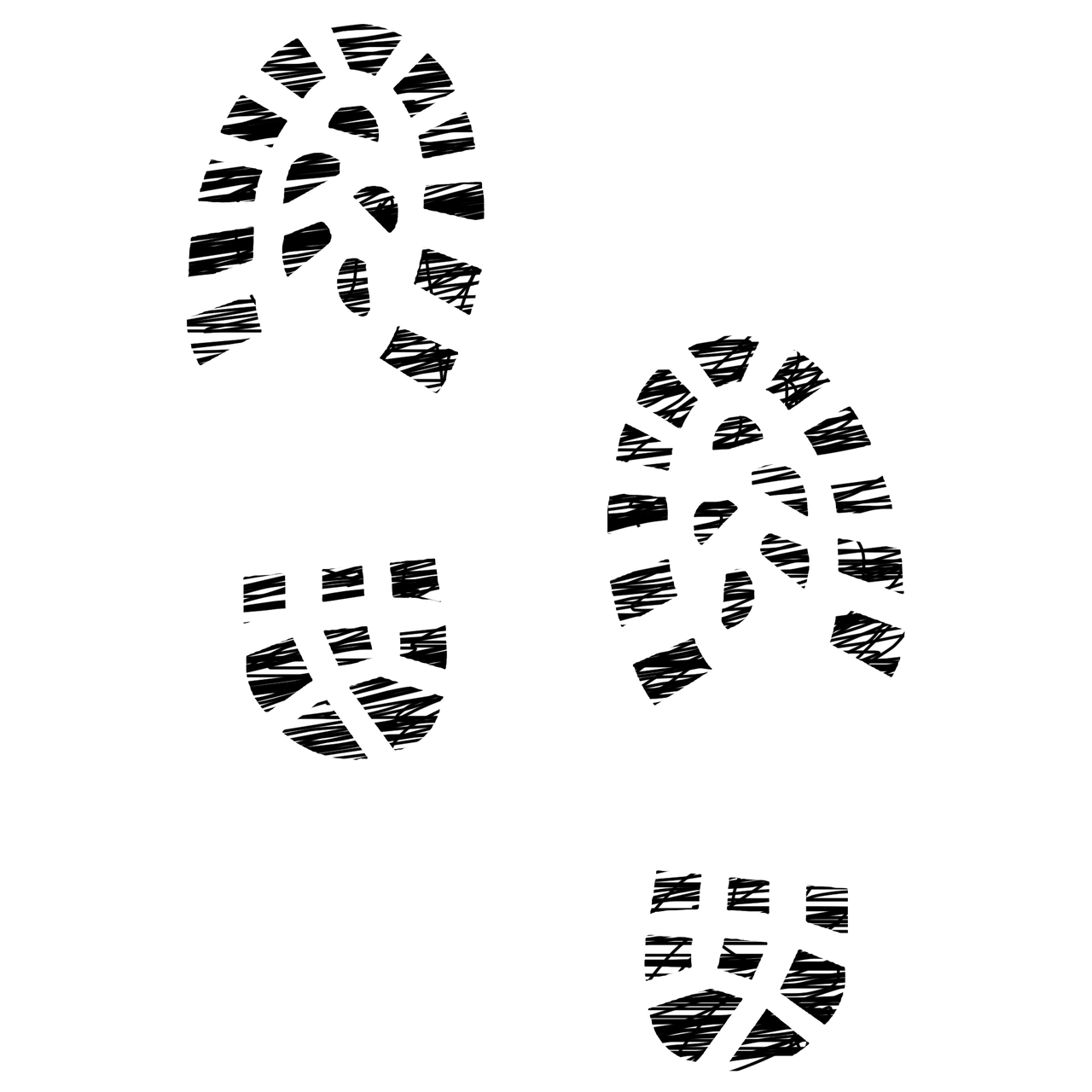
L’élevage joue un rôle crucial dans le changement climatique, représentant environ 14 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), dont 60 % proviennent directement de l’élevage. Le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et le gaz carbonique (CO2) sont les principaux contributeurs à ces émissions, chacun ayant des impacts variés sur l’environnement en fonction de leur durée de vie dans l’atmosphère et de leurs propriétés.
La lutte contre l’émission de méthane, par exemple, est d’une grande importance car ce gaz est environ 28 fois plus puissant que le CO2 en matière de réchauffement climatique, bien qu’il ne persiste que pendant une dizaine d’années. Cela signifie que les efforts de réduction peuvent produire des résultats rapides, ce qui pourrait amplifier les bénéfices pour le climat à court terme.
Les résultats des efforts menés récemment en Europe, notamment une diminution de 39 % des émissions de méthane entre 1990 et 2020, montrent que des stratégies ciblées peuvent être efficaces. Toutefois, à l’échelle mondiale, la concentration de méthane continue d’augmenter, illustrant l’urgence d’adopter des mesures plus robustes.
Les stratégies françaises et européennes visent à atteindre des émissions nettes nulles de chaque gaz d’ici 2050. Pour y parvenir, il est essentiel de maintenir les stocks de carbone dans les sols, en préservant des populations de prairies permanentes et en intégrant des pratiques agricoles adaptées qui favorisent la captation du carbone.
Les innovations dans l’élevage, telles que l’amélioration génétique des animaux ou l’optimisation des régimes alimentaires, jouent un rôle clé. Des projets comme METHANE 2030 ont pour ambition de réduire de 30 % les émissions de méthane dans les filières bovines en dix ans en intégrant plusieurs leviers d’action.
Par ailleurs, il est crucial d’optimiser le rapport entre productions animales et équilibrage des cycles biogéochimiques. Les animaux d’élevage, à travers leurs déjections, contribuent à régler les niveaux de nutriments dans les sols, rendant les effluents essentiels au maintien des cultures saines. Cependant, le déséquilibre dans certaines régions où la spécialisation agricole est forte entraîne une surabondance d’effluents, provoquant des problèmes de pollution de l’eau.
Enfin, l’élevage doit également être repensé pour valoriser ses services environnementaux, souvent quantifiés mais peu rémunérés. Les prairies permanentes, par exemple, constituent des puits de carbone et favorisent la biodiversité tout en diminuant les risques d’incendies et d’inondations. En intégrant ces dimensions dans les politiques agricoles, l’élevage pourra mieux s’aligner sur les objectifs de développement durable.